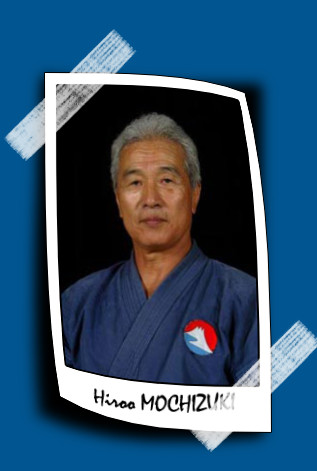Le fondateur : Hiroo Mochizuki
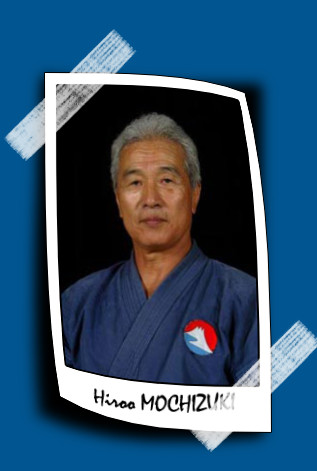
Hiroo Mochizuki naquit le 21 mars 1936 à Shizuoka au Japon.
Son père fut l’illustre maître d’arts martiaux japonais: Minoru Mochizuki.
Hiroo devra attendre l’âge de 13 ans, pour commencer le kendo sous la tutelle de son père.
A cette époque, la famille Mochizuki se trouve en Mongolie où Minoru fut nommé directeur d’un lycée.
En 1946, la famille rentra au japon.
Son père instruisit son fils en judo et en aïkido en 1950.
Pas moins de 4 ans après, le jeune Hiroo Mochizuki devint capitaine de judo de son lycée.
S’il s’entraina avec ferveur au judo, il fut attiré également par le karaté. Il commença son apprentissage par le shotokan avec le maitre Hyogo en 1955.
Ses progrès furent très rapides, à tel point que le pionnier du karaté en Europe, Henri Plée le fit venir en France pour enseigner cet art au mythique dojo de la montagne Sainte Geneviève à Paris.
L’année suivante, il participa à la création de la fédération d’aïkido, de taï jutsu et de kendo en compagnie de Jim Alcheik.
En 1960, il rentra au japon pour finir ses études de vétérinaire, son rêve étant de devenir « cowboy » en Australie.
Lors de son séjour en France, il put découvrir les sports de combats occidentaux et notamment la savate et ses coups de pieds.
Lors de son retour, il chercha au japon un art qui donne ce type de coups de pieds, il découvrit le karaté wado ryu avec le maître Shinji Michihara.
En 1961, il devint capitaine de faculté en judo et vice capitaine de karaté du dojo de maître Michihara.
Son diplôme de vétérinaire lui fut remis en 1962. Il prépara son départ pour l’Australie mais le destin en décida autrement.
L’élève de son père et représentant en France, Jim Alcheik décède lors de la guerre d’Algérie.
Son élève Alain Floquet (futur fondateur de l’aikibudo) demande au maître Minoru Mochizuki de leur envoyer un enseignant.
Le maitre désigna son fils Hiroo. Ce dernier retourna en France et enseigna les arts de son père. En plus, il introduisit en Europe le karaté wado ryu.
En 1964, il participa à la création de la fédération française de karaté.
Dès 1965, Hiroo Mochizuki fut frustré d’enseigner les disciplines de façon séparées. A telle heure, le judo, ensuite le karaté, plus tard l’aïkido etc…
Il décida de créer sa méthode pour palier à cela, il la nomma YOKEN (maitrise du sabre et du poing).
Un jour, il assista à la représentation d’un artiste de cirque qui planta un couteau fixé à l’extrémité d’un fouet dans le tronc d’un arbre, ce fut une révélation !
Hiroo Mochizuki mit en évidence le phénomène d’ondulation commun à tous les arts martiaux.
Le maitre prit la décision de changer le nom de sa méthode en hommage à son père, YOKEN devint YOSEIKAN BUDO (le premier mot est le nom du dojo de son père, le second est le concept de la recherche de la voie) en 1970.
Dès lors, le Yoseikan devint un véritable laboratoire de recherche.
Le grand maitre Minoru Mochizuki nomma, conformément à la tradition japonaise, comme SOKE (successeur) de son école, son fils aîné : Hiroo Mochizuki en 2000.
FD
Qu’est-ce que le yoseikan budo ?
Un peu d’histoire :
Suite au décès de Jim Alcheik en 1962, Hiroo Mochizuki fut mandaté (pour la seconde fois) par son père, le grand maitre Minoru Mochizuki, pour continuer l’enseignement des disciplines de ce dernier en France. (voir la biographie).
Il enseigna : le Yoseikan aïki ju jutsu, le judo, le kobudo (armes anciennes et sabre) de la tenshin shoden katori shinto ryu (version paternel) ainsi que le karaté style wado ryû (il avait représenté le style Shotokan lors de sa première venue en France).
Mais enseigner les disciplines de façon séparées le frustra. D’autant plus que lors de sa première visite, il découvrit des arts martiaux occidentaux comme la boxe anglaise, la savate ou encore la canne française. Pratiques redoutable et très éloignées de la forme de corps du karaté.
Naissance de la discipline :
Comme son père, Hiroo se lança dans des recherches personnelles afin de trouver des réponses à ses interrogations. Cela donna naissance à une méthode appelée Yoken.
Mais le réel déclic se fit lors d’une démonstration de cirque !
L’artiste planta, dans une cible un couteau accroché à l’extrémité d’un fouet.
Hiroo Mochizuki trouva là le moyen de transmettre la puissance des coups à travers le mouvement de hanche et par extension, le lien qui unit tous les arts martiaux, il nomma ce principe : l’ondulation.
La méthode fut dénommée Yoseikan Budo en hommage à son père.
Conception de la pratique :
Dès lors, le yoseikan budo devint un véritable laboratoire d’arts martiaux, en constante amélioration et évolution.
L’école yoseikan n’est pas une synthèse de différents arts martiaux mais une méthode articulée autour des mouvements ondulatoires puis vibratoires (suivant le niveau, on réduit l’amplitude de l’onde pour arriver à la vibration).
Ces derniers mettent en évidence qu’un coup de poing peut correspondre à une projection, une clef, un coup de pieds ou une technique d’arme (forme de corps).
Nous adaptons notre façon de combattre à la situation (souvent conditionnée par la distance) sans nous soucier de la « méthode » employée. Si la réponse appropriée à une attaque de poings est une technique d’aïki alors nous l’utilisons.
Pratique et pédagogie :
Les possibilités sont multiples pour ne pas dire illimitées, ces dernières ne dépendent que de la créativité du pratiquant.
Dans la conception du Yoseikan Budo, la recherche de puissance n’est pas le seul objectif, cette recherche doit impérativement être liée au respect de la biomécanique et des partenaires d’entrainements !
Il faut pouvoir pratiquer le plus longtemps possible et ne pas nuire à son corps.
Pour cela, la pédagogie doit s’adapter aux pratiquants suivant l’âge, la morphologie et l’aptitude physique, pas l’inverse comme c’est souvent le cas.
Il faut conserver le réalisme de la pratique, en toute sécurité. Pour cette raison, le pratiquant dispose de protection anatomique et d’armes en mousse pour les assauts. Ces dernières peuvent, certes, « fausser » le travail car il n’y a pas de danger mais elles permettent de « tester » la technique. De la même façon les armes traditionnelles ne permettent pas de se toucher mais apprennent ce sentiment de danger. Les deux pratiques sont complémentaires.
Philosophie :
Préférons à ce thermes : « travail sur soit ».
Les ars martiaux ne sont en aucun cas un alibi à une violence gratuite !
Eloignons nous également de ces stéréotypes et cette pseudo philosophie véhiculées par certains médias.
Point de mysticisme, c’est au pratiquant à trouver « sa voie ».
Certes ces disciplines trouvent naissance dans les arts de la guerre mais sont aujourd’hui un outil de développement personnel.
Combien d’entre nous iront sur les champs de bataille armé de sabre et de lance ?
La réponse est tellement absurde qu’il n’y aurait aucun sens à pratiquer dans cette optique.
Alors pourquoi pratiquer ?
Qui n’a pas poussé la porte d’un dojo pour « apprendre à se défendre » ?
Cette envie est tout à fait louable mais qui bien souvent se transforme.
On trouve, avec un travail sérieux et le temps, d’autres intérêts à la pratique, souvent même insoupçonné. Les arts martiaux font ressortir nos défauts, nos qualités, nos rapports avec les autres etc…conscient de cela, libre à celui qui le souhaite, d’effectuer un travail sur soi.
La discrimination est bannie, c’est la raison pour laquelle tout le monde est habillé de façon identique, du débutant à l’expert.
Que demande-t-on à un pratiquant ? Entraide, modestie, respect des personnes, des croyances et des cultures.
Outre ces qualités élémentaires, la pratique du yoseikan budo demande : créativité, initiative et combativité.
A la lecture de ce paragraphe, vous constaterez qu’il n’est nullement question d’ésotérisme.
Combien de disciplines peuvent se vanter de rassembler des personnes d’horizons, de cultures, de religions, de classes sociales différentes, du bac-12 au bac +12 ?
Chacun peut apprendre de l’autre, simplement en faisant preuve d’ouverture d’esprit et en étant animé d’un esprit de partage.
La richesse du budo permet à celui qui le souhaite, de se « découvrir ».
"Etre un guerrier signifie combattre le mal à l’extérieur de soi afin de pouvoir affronter le mal à l’intérieur de soi."
(extrait du roman de Patton Boyle « faucon hurlant »)
FD